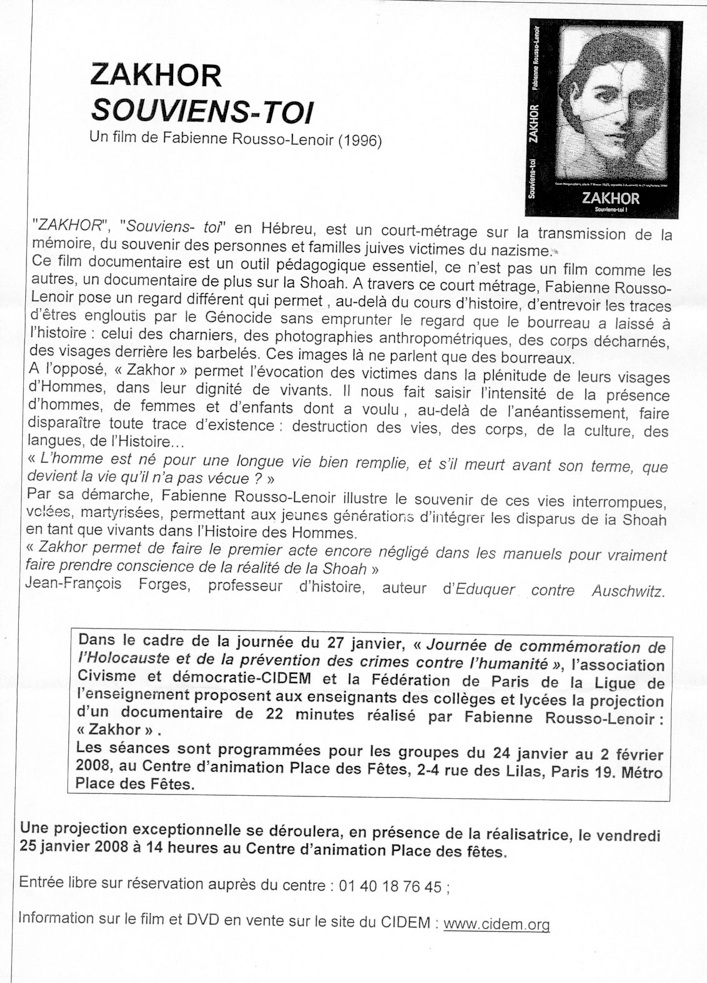Comité “Ecole de la rue Tlemcen”
Au Bulletin Officiel de l’Education nationale du 17 juillet 2008 :
Enseignements élémentaire et secondaire
INSTRUCTIONS PÉDAGOGIQUES
Enseignement de la Shoah à l’école élémentaire
NOR : MENE0800541N
RLR : 514-5
NOTE DE SERVICE N° 2008-085 DU 3-7-2008
MEN
DGESCO A-1
DGESCO B2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré
L’extermination des Juifs d’Europe est inscrite dans les programmes de l’école primaire. Les nouveaux programmes applicables à la rentrée 2008 confirment l’enseignement obligatoire au cours moyen de l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis, un crime contre l’humanité.
Soucieux de la transmission de la mémoire de ces événements tragiques et uniques de l’histoire de notre continent, ainsi que du nécessaire ajustement des enseignements à l’âge des élèves, le Président de la République a récemment demandé que la mémoire des enfants victimes de la Shoah soit privilégiée à l’école.
Les recommandations suivantes sont formulées à partir des travaux du groupe de travail placé sous la direction de Mme Hélène Waysbord-Loing, inspectrice générale honoraire, à qui le ministre de l’éducation nationale a confié la mission de réfléchir à la mise en œuvre pédagogique de la demande du Président de la République.
Inscrit dans sa dimension historique, l’enseignement de la Shoah a une finalité civique et répond à une obligation morale. Il ne s’agit pas seulement de transmettre une mémoire et des connaissances : il faut donner à tous les élèves les éléments de culture et de réflexion leur permettant de refuser toutes les formes de racisme et de discrimination et de comprendre que, contraires à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, elles rendent impossible la démocratie.
L’étude de l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis a pour objectif de faire acquérir progressivement une connaissance précise de ce crime historique majeur perpétré en Europe, de le restituer dans le contexte d’une idéologie raciste et d’un système politique totalitaire. Cette étude intègre la prise de conscience mondiale qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a conduit les instances internationales à adopter la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et à créer la notion de crime contre l’humanité dont le caractère imprescriptible a été intégré au droit national des démocraties.
Cet enseignement est inscrit à trois reprises dans les programmes scolaires : à l’école au cycle des approfondissements (CM2), au collège en 3ème, en première et en terminale au lycée. À chaque niveau, les approches et les démarches, ainsi que la documentation utilisée, doivent être adaptées à l’âge et à la maturité des élèves.
À l’école élémentaire, l’étude de la Shoah doit s’appuyer sur la complémentarité des disciplines : elle s’effectuera principalement en histoire, mais elle pourra prendre appui sur des œuvres d’art ou sur des livres dans le cadre de l’enseignement d’histoire des arts ou de littérature.
L’objectif est à ce niveau de donner des premiers repères, notamment chronologiques mais aussi spatiaux car la dimension européenne du crime et de son organisation doit être évoquée. Il s’agit aussi de contribuer à l’éducation morale et civique des élèves en commençant à approcher la question de la responsabilité personnelle et collective, celle aussi de la résistance à la barbarie. Les élèves seront ainsi amenés à une première compréhension de la notion de crime contre l’humanité ainsi qu’à celle de droits humains universels.
Pour aborder cet enseignement, les maîtres sont libres de leurs choix pédagogiques et plusieurs approches, souvent complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants victimes est cependant une entrée à privilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un itinéraire, de l’exemple singulier d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches - l’école, la commune, le département - constitue une approche pédagogique respectueuse de la sensibilité des enfants.
À partir d’un exemple, les élèves appréhenderont la déshumanisation systématique des victimes jusqu’à l’extermination : la discrimination, les arrestations, les camps d’internement, les convois, puis les camps d’extermination.
À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, des justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles.
Ces cas singuliers inscrits dans l’histoire constitueront, par leur dimension mémorielle, la première étape d’un savoir que les enseignements d’histoire au collège puis au lycée permettront de consolider.
En complément des enseignements, la Journée de mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, instituée le 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, constituera un moment privilégié de mémoire et de réflexion dans les écoles.
Pour aider les maîtres dans cet enseignement délicat qui doit allier à la fois nécessité de conserver une mémoire et d’édifier le socle d’une culture historique, un livret pédagogique sera diffusé auprès des enseignants des classes de CM2 à la rentrée prochaine. Un portail internet sera créé pour mettre également à leur disposition un ensemble de ressources : accès à la base de données des enfants déportés de France développée par le mémorial de la Shoah, bibliographie, filmographie, sitographie, pratiques exemplaires.
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI
Education nationale
Courrier adressé à la presse et à la commission “Waysbord”
(Ministère de l’éducation nationale)
Avril 2008
Mémoire…
Un nouveau devoir pour chaque enfant de cm2? Non!
Un vrai travail collectif de mémoire et d’Histoire
La décision de Nicolas Sarkozy – de “confier la mémoire » d’un enfant français victime de la Shoah à chaque élève de CM2, dès la rentrée prochaine” a donc fait flop dès énoncée. Heureusement.
Simone Veil(“à la seconde, mon sang s’est glacé… inimaginable, insoutenable et injuste… on ne peut pas infliger ça à des petits de dix ans... on ne peut pas demander à un enfant de s’identifier à un enfant mort… cette mémoire est beaucoup trop lourde à porter”, Annette Wievorka (“proposition tout à fait indécente… coup mémoriel sans réflexion ni profondeur »), Boris Cyrulnik (”deux dangers/ne pas en parler/mal en parler...gentillesse criminelle”), Henri Rousso (”de l‘Histoire, on ne nous montre plus aujourd’hui qu’un usage utilitaire. Le passé est devenu un entrepôt de ressources politiques ou identitaires où chacun puise à son gré ce qui peut servir ses intérêts immédiats”), Claude Lanzmann (« Le parrainage d'une victime par un élève ou par une classe était enterré avant même qu'on ne se réunisse. Ce n'était pas praticable. »...
... des enseignants), des psys et quelques autres... ont dit ce qu'il fallait.
L'idée n’était ni « formidable » ni novatrice. Comme si rien n’avait été fait jusque-là, alors que, depuis des années, des actions (locales, nationales) sont menées par de multiples associations*, des livres édités, des films réalisés, des expositions présentées pour transmettre la mémoire et le contexte historique du génocide.
Des interviews du Comité Tlemcen invité à réagir ne sont passées à l’antenne que quelques images et… deux phrases brèves sur FR3, une seule, la première, sur FR2,une autre sur i-télé.
“C’est procéder comme à l’habitude du Président par injonction et la question posée nous semble demander beaucoup plus de sérieux et de réflexion pour sa mise en oeuvre… Alors, bien sûr, lutter contre l’antisémitisme et tous les racismes, cela demande un travail de fond dans les écoles, comme celui que nous avons fait dans le 20ème pendant 10 ans…”. La suite fut coupée. C’est un peu court, très réducteur et mérite qu’on y revienne.
En 1997, à l’initiative d’un petit groupe d'anciens élèves (écoliers des années 40) de l'école de la rue Tlemcen qui veulent rappeler le souvenir de leurs copains, frères et soeurs, morts en déportation, une plaque est apposée. En 1998, des enseignants, des amis se joignent à eux et fondent le Comité Tlemcen dont l’objectif, modeste et ambitieux est de réaliser un travail de mémoire sur tout le 20° arrondissement de Paris.
Modeste, géographiquement (le 20ème).
Ambitieux:
-Tisser un large partenariat qui associe la population, les parents d'élèves, les jeunes, les enseignants, pour faire vivre dans toute son ampleur le destin tragique et le souvenir de ces enfants déportés;
-en évoquant ces enfants, dire ce que fut l'horreur d'un fait majeur du 20ème siècle: le génocide par l’extermination de millions d'êtres humains coupables d'être nés juifs;
-apposer des plaques perpétuant la mémoire des enfants assassinés;
-lutter contre l'oubli et le négationnisme;
-réaliser brochures, expositions, retraçant les faits, destinées aux habitants, aux établissements scolaires pour que les jeunes générations sachent où mènent le racisme, l'exclusion, l'intolérance et la passivité.
Parce que cette action nous concerne tous, nous avons voulu réunir le plus grand nombre, que ces rassemblements soient des évènements importants dans la vie de notre arrondissement, dans ce quartier populaire et lieu traditionnel d’immigration – polonaise, italienne, arménienne, espagnole, portugaise … autrefois, et aujourd’hui, maghrébine, africaine, asiatique… - pour associer chacun, chacune, les uns et les autres, dans l’affirmation des valeurs communes de tolérance, d’antiracisme, de démocratie.
En allant dans chaque école, chaque classe pour rappeler la mémoire de ces enfants, nous voulons lutter contre toutes les formes de discrimination dont les enfants d’aujourd’hui pourraient être victimes. Ce travail s’insère dans l’effort de l’école publique pour faire de chaque enfant un citoyen informé, conscient, capable de lutter contre l’injustice et le racisme.
Toute l’entreprise du Comité Tlemcen ramène à l’école. Parce que l’école, c’est la deuxième maison des enfants, leur maison commune où tous sont accueillis et apprennent à vivre ensemble. Autour de chaque école, de chaque groupe d’écoles, c’est comme un village. La communauté scolaire rassemble: on se côtoie, on se parle, on se réunit, on se connaît… C’est pourquoi, sur les murs de leur école, nous avons inscrit les noms de tous ces enfants à qui on a volé la vie et avons choisi d’illustrer la couverture du livre “Se souvenir pour construire l’avenir”** par l’image symbole d’une école.
Nous avons bien sûr rencontré les enseignants pour leur présenter notre projet – sans leur concours, rien n'aurait été possible – mais aussi les parents d'élèves. Il a fallu répondre parfois aux réticences – "c'est loin, c'est le passé…" -, plus souvent aux craintes, aux hésitations, légitimes, compréhensibles: parler de la mort programmée des enfants juifs d'hier aux enfants d'aujourd'hui, introduire la mort à l'école – lieu de vie - ce n'est pas spontanément évident.
Il a fallu répondre, rassurer et convaincre.
Répondre que le silence, que l'oubli étaient impossibles, qu'il fallait que chacun sache, qu'il fallait que ces enfants martyrs reviennent dans la mémoire de leur école - l'école, la maison commune des enfants. Ne pas oublier pour que ne se répète pas l'infâmie.
Rassurer: on s'adresse aux enfants avec précaution en adaptant le discours à leur âge.
Convaincre, en s'inspirant de ce qu'écrit Claude Roy dans sa préface au beau livre de Jo Hoestlandt, " La grande peur sous les étoiles":
"Le mal et le malheur existent. Faut-il à tout prix en tenir abrités les enfants? Les préserver, au chaud, à l'abri du malheur -et de vie- aveugles, sourds, heureux?
Jo Hoestlandt, qui vous aime et sait vous raconter de belles histoires, pense qu'il ne faut pas vous "raconter d'histoires" et que les enfants ont droit à la vérité comme les grands, même quand la vérité fait mal. Les rafles des juifs à Paris pendant l'occupation, ce n'est pas matière à conte bleu, à berceuse apaisante. Elle en a fait le sujet d'un bref et juste récit, un épisode d'amour brisé entre deux petites filles, Lydia qui est née sous la mauvaise étoile jaune d'une mauvaise humanité, et son amie, qui ne comprend pas et comme tous les enfants (comme devraient le faire tous les hommes) demande: "Pourquoi?" .
Un des SS d'Auschwitz, raconte Primo Lévi qui y fut déporté, répondit quand ses victimes le questionnaient "Ici, pas de pourquoi".
Les enfants ont la vertu d'étonnement et la force d'indignation, ressource que les adultes perdent parfois.
Vous n'arrêtez pas de répéter obstinément : Pourquoi?
Mais dans La grande peur sous les étoiles, c'est la question fondamentale, le "Pourquoi" premier qui est posé.
Pourquoi la haine ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la cruauté des uns et l'indifférence des autres ?
Peut-on répondre à la question ? Mais peut-on ne pas la poser?
Ce que cette histoire nous rappelle, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour poser, se poser les vraies questions, les interrogations premières, qui maintiennent le coeur en éveil, et empêchent de prendre son parti de l'injustifiable."
Nous avons répondu et, croyons-nous, rassuré et convaincu.
Mais, au cours de ces rencontres, nous avons constaté que beaucoup ignoraient le contexte politique-et ses terribles réalités- qui a organisé une politique d’exclusion et conduit, étape par étape à la solution finale. Alors, oui, il était important, essentiel, de dire ce qui s'est passé ici: les lois anti-juives, les persécutions et diverses interdictions, le port de l'étoile jaune. En mai 1941,la rafle dite du « billet vert » a, dans un premier temps, interné, puis déporté les pères de ces mêmes enfants avec, pour justificatif officiel sur les registres de baraque des camps du Loiret, la mention préfectorale : « En surnombre dans l’économie nationale ».
En juillet 1942, la rafle du Vel’d’Hiv’ – 13 152 arrestations à Paris dont 4115 enfants, 4378 dans le 20ème dont plus de 1100 enfants par 255 équipes d'agents capteurs de la police française, la détention dans les centres de rassemblement (commissariat Gambetta et rue Boyer), puis le transport au Vel’d'Hiv’ dans 7 autobus réquisitionnés, l'internement dans les camps du Loiret, puis Drancy et enfin le terrible voyage pour Auschwitz.
Important, essentiel de dire et écrire les noms de ces enfants déportés, d'afficher leurs visages, de dire où ils habitaient –certaines maisons sont toujours là, habitées. Et dire aux parents d'aujourd'hui que ces enfants fréquentaient les mêmes écoles que leurs propres enfants. Et dire aussi que ce qui s'était passé ici s'était aussi passé partout ailleurs, en France et en Europe.
11 400 enfants juifs furent déportés de France. D'après nos recherches, 1 270 étaient scolarisés dans le 20ème.
Et 132 petits n'ont pas eu le temps d'aller à l'école.
Nous sommes intervenus dans 63 écoles, 9 collèges. Nous avons témoigné des centaines de fois, rencontré des milliers d'élèves, présenté des expositions - Hôtel de Ville de Paris, Mairie du 20° - et organisé 15 journées de rassemblements pour l'apposition des plaques. Pour enrichir la démarche historique, en complément des nombreux témoignages, un dossier de documents d’archives a été élaboré par le Comité.
Rappelons aussi l’apport essentiel qu’a représenté le « Mémorial des enfants juifs déportés de France » de Serge Klarsfeld. Les listes, les photos patiemment rassemblées, ont largement contribué au travail rigoureux de croisement des documents, listes des convois et registres des écoles, permettant la mise au point des plaques commémoratives. L’initiative a fait tache d’huile dans tout Paris, en banlieue et dans d’autres villes de France, Lyon, Marseille, Nice… et aussi dans d’autres pays comme la Belgique, l’Italie.
Ce fut pour beaucoup une révélation, une grande émotion qui provoqua questionnement et réflexion sur l'ampleur de la tragédie, la prise de conscience de l'universalité d'Auschwitz qui concerne la totalité des êtres humains, sa signification pour aujourd'hui et pour demain.
En témoignent la qualité de l'accueil dans les écoles - des enseignants et des élèves.
Les enseignants ont été des éveilleurs de conscience, en s'impliquant dans notre projet, en accueillant les interventions du comité, en réalisant un travail en profondeur dans leurs classes.
Et les élèves – petits et grands, de toutes les couleurs-, oui, ils ont cette "vertu d'étonnement" et cette "force d'indignation" dont parle Claude Roy. Ils l'ont montré par leur participation, par l'intérêt manifesté lors des témoignages, par la pertinence de leurs questions, de leurs réflexions, et bien sûr par leurs réalisations – textes, poèmes, dessins, chants, théâtre, enquêtes et expositions…
En témoignent aussi les rassemblements organisés devant chaque école à l'occasion de la pose des plaques. Beaucoup de monde, combien de milliers du 10 avril 1999 devant l'école Julien Lacroix au 28 novembre 2004 square Edouard Vaillant – élèves, enseignants, parents, habitants du quartier, élus, membres d'associations, et membres du comité dont beaucoup anciens élèves des années 40?
Ces rassemblements de tant de gens, tous différents et pourtant si semblables, ont été des moments rares, empreints de joie grave, parce que nous avions alors le sentiment partagé d'être unis par des valeurs communes, universelles, de démocratie, d'antiracisme et de fraternité.
Bien sûr, cela ne suffira pas. Pas de naïveté, pas d'angélisme non plus. Le monde, ici et ailleurs, est toujours en proie aux racismes. On en voit à l'œuvre les méfaits, dans tous les sens. Alors vigilance, vigilance active, toujours!
Certes, la France n'est pas un pays raciste, pourtant…
Pourtant, aujourd'hui, en France, des cimetières sont profanés, des tombes insultées, des synagogues, des mosquées sont vandalisées, incendiées, des personnes sont agressées du fait de leur appartenance communautaire… des jeunes, des enfants sont insultés, brutalisés, discriminés et humiliés, parce que porteurs d'une kippa, parce que la couleur de leur peau…
Quelles qu'en soient les raisons, ces actes sont injustifiables, intolérables.
Et parfois, en France, aujourd'hui, la police vient chercher des enfants, des jeunes dans les écoles, les enferme dans des centres de rétention, ces "horreurs de la République" que dénonçait le rapport Mermaz en 2001. En 2007, ces centres ont vu passer près de 300 mineurs (y compris des nouveaux nés). Des enfants sont arrachés à leur école, des familles sont brisées. Et parce que cela aussi est intolérable, certains d’entre nous ont parrainé des jeunes majeurs menacés d’expulsion.
Certes, la France d'aujourd'hui n'est pas celle de l’occupation nazie, du régime de Vichy, des années noires et nous ne faisons pas d'amalgame. Mais l’Histoire nous incite à déceler où et comment surgit l’inacceptable, à décrypter les signes précurseurs, le recours aux boucs-émissaires. Les campagnes de stigmatisation qui précèdent et nourrissent les dérives tragiques, les relents xénophobes, ne sont jamais innocentes et nous conduisent à analyser les réalités d’aujourd’hui, sans les amplifier, sans les minimiser, et chercher à comprendre. Et comprendre, c'est surtout ne pas justifier et tolérer l'intolérable - ne tolérons rien – mais lutter contre cet intolérable.
Nous en avons la volonté et les moyens:
la conviction antiraciste, à condition qu'elle soit agissante;
la loi, qui désigne l'antisémitisme, le racisme comme des délits et non comme des opinions;
la laïcité, si précieuse, qui garantit la liberté de conscience, la liberté d'opinion, le respect de l'identité de chacun; parce qu'elle nous permet de vivre ensemble, contrairement au danger du communautarisme qui enferme, sépare et oppose.
enfin, nous avons ces grands textes qui défendent, protègent les droits fondamentaux de tout être humain : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention de Genève, la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant, la Convention européenne des Droits de l'Homme. Faisons les vivre.
*notamment,
CDJC :Centre de Documentation Juive Contemporaine
FNDIRP :Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants
FFDJF :Fédération des Fils et Filles des Déportés Juifs de France
**Se souvenir pour construire l’avenir
Un livre-outil contre le racisme
Cet ouvrage est le fruit de dix années de travail dans les établissements scolaires du 20ème arrondissement de Paris, à la mémoire des enfants du quartier morts en déportation parce que nés juifs.
On y retrouve les moments forts des cérémonies organisées pour les poses de plaques commémoratives des écoles et collèges : interventions des élus des mairies du 20ème et de Paris, des membres du Comité, des inspecteurs de l’Education Nationale, des enseignants et surtout les participations multiples et toujours émouvantes des élèves : chants, poèmes, textes, dessins, courriers, panneaux d’exposition…On pourra lire aussi dans ce livre les témoignages de rescapés de la déportation, de résistants, d’enfants cachés ; témoignages qui ont été des moments essentiels du travail de mémoire engagé dans les classes en coopération active avec les enseignants.
La liste complète des enfants du 20ème morts en déportation ainsi que de nombreuses photos sont dans le livre, extraites du « Mémorial des enfants juifs déportés de France » de Serge Klarsfeld. Enfin des documents historiques, une bibliographie et une filmographie complètent l’ouvrage pour lui donner sa dimension pédagogique d’outil de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, préoccupation constante du Comité.